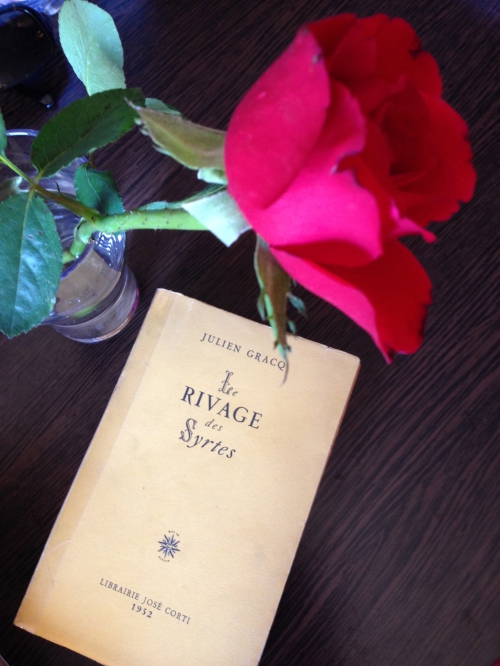Le Rivage des Syrtes, de Julien Gracq
J’aime l’écriture, le style des romans de Julien Gracq.
Pour Gracq le roman relève d’abord de l’imagination, du songe, d’une certaine rêverie qu'il sait nous faire partager. Comme lecteur je suis plongé dans l’état dans lequel Gracq lui-même, selon ses propres confidences, s’éprouve à certaines heures - telles que celles évoquées par Rousseau dans la Cinquième Promenade :
« Je suis certain qu’un puissant courant imaginatif peut sourdre de la perception, vive, et - entendez-le bien - entièrement blanche, vide, de telles heures, dont on peut s’imbiber vraiment - heures vécues à même leur durée, sans s’accrocher à aucune bouée. Un grand courant imaginatif : un livre, par exemple. J’en suis certain parce que cela m’est arrivé : l’envie de commencer un livre m’est presque toujours venue à de telles périodes. » (Les Yeux bien ouverts, in Préférences).
Le Rivage des Syrtes, que je me suis plu récemment à relire dans une édition ancienne retrouvée sur les quais à Paris, ne contient aucune référence à une réalité historique. Les lieux sont indéterminés (vaguement situés aux confins d’un Orient imaginaire) comme dans un songe. Le récit est celui d’une aventure individuelle : celle d’Aldo, le narrateur et le héros du livre - et c’est en même temps l’histoire (imaginaire) d’un pays : Orsenna, dont le destin va se trouver lié à celui du héros.
Orsenna, un pays vieilli, en léthargie, est en guerre depuis des décennies avec le Farghestan, l’ennemi mystérieux, invisible mais toujours présent, situé face aux territoires d’Orsenna par delà la mer des Syrtes. Le pays sombre inexorablement dans le déclin.
Très loin à l’autre bout du pays, vers le sud, après un voyage qui paraît interminable, on atteint le rivage des Syrtes. Là se tient, dressée face au Farghestan telle une vigie improbable, l’Amirauté, une vieille bâtisse quasi en ruines, occupée par une petite garnison sous les ordres de Marino, le commandant de la forteresse, chargé de surveiller la passe à l’aide de quelques navires de guerre vétustes. Mais les hostilités ont cessé par lassitude. Les soldats sont devenus paysans. Rien ne se passe dans ce monde immobile.
Le héros du roman, Aldo, est envoyé comme Observateur (délégué) de la Seigneurie (le gouvernement) auprès de la garnison du "fort des Syrtes". A Orsenna, il a rencontré une jeune femme, la princesse Vanessa Aldobrandi, issue d'une grande et ancienne famille. Vanessa lui a ouvert les yeux, elle l'a « initié » à la vraie situation du pays, son état de lente agonie ; elle a été pour lui « la minime fêlure » qui révèle la vraie profondeur des choses.
Arrivé au fort des Syrtes, Aldo sent grandir en lui le sentiment de vide, d’immobilité, de déclin que lui inspire ce monde presque mort, dans lequel il semble qu’il n’y ait plus de place pour le moindre événement. Ce monde endormi a un mystérieux « centre de gravité » : la chambre des cartes. Là, fasciné, Aldo va découvrir les cartes de la mer des Syrtes sur lesquelles figure, parallèlement à la côte, à quelque distance sur la mer, une ligne continue d’un rouge vif : c’était celle depuis longtemps acceptée d’un accord tacite pour ligne frontière, et que les instructions nautiques interdisaient de franchir en quelque cas que ce fût.
Rien ne se passe, à condition de ne pas franchir la ligne interdite. Le commandant Marino est le garant du maintien de la paix dans l’immobilité .
Aldo, lui, se sent « de la race des veilleurs ». Poussé par Vanessa, il va vouloir aller voir de l’autre côté de la mer des Syrtes : appareiller vers l’ailleurs. Il franchit avec le Redoutable la ligne interdite.
En franchissant la ligne rouge Aldo va provoquer une réaction du Farghestan et réveiller la guerre qui conduira Orsenna à la catastrophe - d’où rejaillira une nouvelle naissance.
Voilà, très résumée, la trame du récit.
Emporté dans la rêverie que secrète le texte, dans mon imaginaire je comprends qu'on puisse sentir une part en nous qui s'identifie à Marino. Marino ne souhaite pas que les choses bougent dans ce monde ancien dans lequel il a trouvé, et trouve encore ses repères. Il résiste à voir les signes. Je comprends cette part en nous, je la ressens parfois comme mienne, mais je sais que la vie, avec sa part d'inconnu, n'est pas de ce côté. Lorsque Marino comprend l'inutilité de ses efforts pour empêcher le nouveau d'advenir, il ne peut que disparaître.
La part vivante en nous est cette part d'Aldo-Vanessa qui aspire à appareiller vers l'ailleurs. Aldo perçoit un appel : quelque chose lui fait signe. Il répond à cet appel et part en quête de ce quelque chose, qui est sa vérité. Il franchira des interdits, passera outre, provoquant par son acte une catastrophe pour son pays, mais de cette catastrophe viendra le salut, c'est-à-dire une re-naissance. Le vieux Danielo, le chef de la ville, révèle à Aldo, effrayé des conséquences de son acte, son vrai sens : "Il y a plus urgent que la conservation d'une vie, n'est-ce pas Aldo, si tant est qu'Orsenna vive encore. Il y a son salut. Toutes choses ne finissent pas à ce seuil que tu envisages uniquement."
La fin d'Orsenna signifie aussi le salut du pays. Les choses ne finissent pas à ce "seuil" : c'est plutôt un nouveau départ, qui évite au pays de se perdre corps et âme dans la décadence. Le pays est "remis dans le jeu". Telle est la "bonne mort" d'Orsenna, qui, comme Aldo et Vanessa et grâce à eux, répond à la question : "Qui vive ?".
Face à l'immobilisme, à la tentation de la conservation, le vieux Danielo se fait l'apôtre du risque et de la jeunesse. Danielo a compris qu'il fallait relever le défi pour qu'Orsenna meurt de sa bonne mort. Il donne pour ainsi dire quitus à Aldo pour sa conduite. Et Aldo comprend peut-être mieux cette singulière extase qu'il a ressenti au moment de franchir la ligne interdite : "Je me sentais flotter très haut, dans une extase calme. Il me semblait que soudain le pouvoir m'eût été donné de passer outre, de me glisser dans un monde rechargé d'ivresse et de tremblement."
La transgression accomplie, Aldo, bouleversé par les conséquences de son acte, avait tenté d'en rejeter la responsabilité sur son amie Vanessa qui l'y avait poussé : "Je suis allé là-bas, Vanessa, et tu l'as voulu" ; "Tu as désiré que j'aille là-bas. Tu me l'as fait comprendre". Mais la vérité est ailleurs. Ni Aldo, ni Vanessa n'ont agi de leur plein gré, librement. Tels les héros des tragédies grecques, ils ont été les instruments du destin. Vanessa en a eu l'intuition : "Ni toi ni moi ne comptons tellement dans cette affaire. Quelqu'un est allé là-bas. Parce qu'il n'y avait pas d'autre issue. Parce que c'était l'heure. Parce qu'il fallait que quelqu'un y aille…"
Le vieux Danielo donne tout son sens à cet acte qu'il assume, et qui dépasse Aldo : "Il baptisait le monde. Au lieu qu'il fût un aboutissement, tout partait de lui à neuf. Il était redoutable, il était imprudent ; la sagesse des hommes, la sûreté de la ville le déconseillait… Le monde, Aldo, attend de certains êtres et à de certaines heures que sa jeunesse lui soit rendue ; un bouillonnement trouble se bouscule contre la porte qui n'attend pour s'ouvrir qu'une permission où toute l'âme se baigne : ai-je pu penser une seconde à la sécurité d'une ville vieille et pourrie ? Elle est raidie dans son sépulcre et murée dans ses pierres inertes, - et de quoi peut encore se réjouir une pierre inerte, si ce n'est de redevenir le lit d'un torrent ?"
Ainsi s'accomplit la double aventure d'un homme et d'un pays qui tous les deux répondent au même appel : celui de l’ailleurs.
Bonnes feuilles
pour apprécier l’écriture et le style de Julien Gracq
Premières lignes du roman :
J'appartiens à l'une des plus anciennes familles d'Orsenna. Je garde de mon enfance le souvenir d'années tranquilles, de calme et de plénitude, entre le vieux palais de la rue San Domenico et la maison des champs au bord de la Zenta, où nous ramenait chaque été et où j'accompagnais déjà mon père, chevauchant à travers ses terres ou vérifiant les comptes de ses intendants. Mes études terminées dans l'ancienne et célèbre université de la ville, des dispositions assez naturellement rêveuses, et la fortune dont je fus mis en possession à la mort de ma mère, firent que je me trouvai peu pressé de trouver une carrière. La Seigneurie d’Orsenna vit comme à l’ombre d’une gloire que lui ont acquise aux siècles passés le succès de ses armes contre les Infidèles et les bénéfices fabuleux de son commerce avec l’Orient : elle est semblable à une personne très vieille et très noble qui s’est retirée du monde et que, malgré la perte de son crédit et la ruine de sa fortune, son prestige assure encore contre les affronts de ses créanciers ; son activité faible, mais paisible encore, et comme majestueuse, est celle d’un vieillard dont les apparences longtemps robustes laissent incrédule sur le progrès continu en lui de la mort. (…) (Le Rivage des Syrtes, Librairie José Corti, 1952, p.7)
Le voyage d’Aldo vers les Syrtes :
Le pavé romain pointait par places au travers de ces routes étroites, parfois recouvertes en voûte d’un berceau serré de verdure où la vigne s’enlaçait encore aux branches ; au bout de ces perspectives, braquées comme le canon d’une arme, s’ouvraient des lointains de vallées d’un bleu de matin. La splendeur mûre et l’opulence d’Orsenna montaient au coeur, de toutes ces campagnes gorgées de l’automne ; au-dessus de nous, la fraîcheur s’égouttait lentement des branches en se diluant comme une odeur dans l’air transparent, de grand treillis de soleil filtraient jusqu’à la route. Une plénitude calme, une bienvenue de jeunesse pure montaient de ce profond matin. Je buvais comme un vin léger cette fuite douce au travers des campagnes ouvertes, mais c’était moins l’avenir béant que la persistance autour de moi d’une présence assurée et familière, et pourtant déjà condamnée, qui m’emplissait le coeur : m’éloignât à toute vitesse de ma ville, je respirais Orsenna de tous mes poumons. Je songeais combien les fibres qui me retenaient à ce pays étaient profondes, comme à une femme dont la beauté trop mûre et trop tendre vous tient captif ; puis, de temps en temps, sur cet attendrissement mélancolique, comme un souffle vif et alarmant dans une nuit tiède, glissait ce mot troublant : « la guerre », et les couleurs si pures du paysage autour de moi viraient à une imperceptible teinte d’orage. (…) (p.17)
L’Amirauté :
Ainsi surgie des brumes fantomatiques de ce désert d’herbes, au bord d’une mer vide, c’était un lieu singulier que cette Amirauté. Devant nous, au delà d’un morceau de lande rongé de chardons et flanqué de quelques maisons longues et basses, le brouillard grandissait les contours d’une espèce de forteresse ruineuse. Derrière les fossés à demi comblés par le temps, elle apparaissait comme une puissante et lourde masse grise, aux murs lisses percés seulement de quelques archères, et des rares embrasures des canons. La pluie cuirassait ces dalles luisantes. Le silence était celui d’une épave abandonnée ; sur les chemins de ronde embourbés, on n’entendait pas même le pas d’une sentinelle ; des touffes d’herbes emperlées crevaient çà et là les parapets de lichen gris ; aux coulées de décombres qui glissaient aux fossés se mêlaient des ferrailles tordues et des débris de vaisselle. La poterne d’entrée révélait l’épaisseur formidable des murailles : les hautes époques d’Orsenna avaient laissé leur chiffre à ces voûtes basses et énormes, où circulait un souffle d’antique puissance et de moisissure. Par les embrasures ouvertes au ras du pavé, des canons aux armes des anciens podestats de la ville béaient sur un gouffre immobile de vapeurs blanches d’où montait le souffle glacial du brouillard. Une atmosphère de délaissement presque accablante se glissait dans ces couloirs vides où le salpêtre mettait de longues coulures. Nous demeurions silencieux, comme roulés dans le rêve de chagrin de ce colosse perdu, de cette ruine habitée, sur laquelle ce nom, aujourd’hui dérisoire, d’Amirauté mettait comme l’ironie d’un héritage de songe. (…) (pp. 22-23)
Marino :
C’était bien le vrai Marino que j’avais devant moi et que j’allais combattre : de connivence avec les choses familières, appuyé sur elles et les étayant de sa masse protectrice - un barrage d’obstination douce et tenace à l’inattendu, au soudain, à l’ailleurs. La pipe, posée sur une pile de dossiers, était un défi au tonneau de poudre. La main lente et appliquée de laboureur festonnait d’une grosse encre, au travers des pages, le sillon quotidien. Une longue suite de journées égales, de journées sans date et sans secret, avait forgé cette armure inaltérable dont le toucher dissipait les fantômes, calfaté cette cloche à plongeurs où - à jamais comme si de rien n’était - se consommait un prenant mystère d’habitude (…) (p. 46)
La première rencontre avec Vanessa Aldobrandi à Orsenna :
Les jardins Selvaggi dans le mois de mai, au sortir du labyrinthe de rocailles et de marbre qui surplombe la colline, sont une seule nappe de soufre clair qui flambe d’un blanc de coulée jusqu’au bas de la pente et vient mordre en festoiements de vagues la falaise opposée de forêts sombres qui clôt de ce côté Orsenna comme un mur. Passé le faîte de la colline qui l’isole des bruits familiers de la ville, à midi l’odeur des narcisses et de jacinthes reflue sur le vallon comme un vertige tournoyant, pareille à l’attaque sur l’ouïe d’une note trop aigüe qui creuse pourtant, avant de la combler aussitôt, la soif d’une note plus aigüe et plus déchirante encore. (…) On connaissait peu à Orsenna ces jardins à demi abandonnés ; je m’y glissais souvent vers midi, où j’étais sûr de n’y trouver personne, avec l’enchantement toujours neuf qu’on éprouve à faire jouer une porte secrète et indéfiniment complice. Il était là, chaque fois comme pour moi seul ravivé dans son incandescence - dans un au-delà instantané et dérisoire de la promesse également, inépuisablement dispensateur.
J’avais quitté l’Université, ce matin-là, de bonne heure et pris congé d’Orlando à quelques rues de là : ces promenades clandestines étaient de celles dont il avait le secret de me faire rougir. Je descendais déjà les dernières marches de mon belvédère préféré quand une apparition inattendue m’arrêta, dépité et embarrassé : à l’endroit exact où je m’accoudais d’habitude à la balustrade se tenait une femme.
Il était difficile de me retirer sans gaucherie, et je me sentais ce matin-là d’humeur particulièrement solitaire. Dans cette position assez fausse, l’indécision m’immobilisa, le pied suspendu, retenant mon souffle, à quelques marches en arrière de la silhouette. C’était celle d’une jeune fille ou d’une très jeune femme. De ma position légèrement surplombante, le profil perdu se détachait sur la coulée de fleurs avec le contour tendre et comme aérien que donne la réverbération d’un champ de neige. Mais la beauté de ce visage à demi dérobé me frappait moins que le sentiment de dépossession exaltée que je sentais grandir en moi de seconde en seconde. Dans le singulier accord de cette silhouette dominatrice avec un lieu privilégié, dans l’impression de présence entre toutes appelée qui se faisait jour, ma conviction se renforçait que la reine du jardin venait de prendre possession de son domaine solitaire. Le dos tourné aux bruits de la ville, elle faisait tomber sur ce jardin, dans sa fixité de statue, la solennité soudaine que prend un paysage sous le regard d’un banni ; elle était l’esprit solitaire de la vallée, dont les champs de fleurs se colorèrent pour moi d’une teinte soudain plus grave, comme la trame de l’orchestre quand l’entrée pressentie d’un thème majeur y projette son ombre de haute nuée. La jeune fille tourna soudain sur ses talons tout d’une pièce et me sourit malicieusement. C’est ainsi que j’avais connu Vanessa. (…) (pp. 54-55)
La « bonne mort » d’Orsenna, selon Danielo :
Un Etat ne meurt pas, ce n'est qu'une forme qui se défait. Un faisceau qui se dénoue. Et il vient un moment où ce qui a été lié aspire à se délier, et la forme trop précise à rentrer dans l'indistinction. Et quand l'heure est venue, j'appelle cela une chose désirable et bonne. Cela s'appelle mourir de sa bonne mort. (…)
Il y a trop longtemps qu'Orsenna n'a été remise dans les hasards. Il y a trop longtemps qu'Orsenna n'a été remise dans le jeu. Autour d'un corps vivant, il y a la peau qui est tact et respiration ; mais quand un Etat a connu trop de siècles, la peau épaissie devient un mur, une grande muraille : alors les temps sont venus, alors il est temps que les trompettes sonnent, que les murs s'écroulent, que les siècles se consomment et que les cavaliers entrent par la brèche, les beaux cavaliers qui sentent l'herbe sauvage et la nuit fraîche, avec leurs yeux d'ailleurs et leurs manteaux soulevés par le vent. (…) (p. 348)
A découvrir aussi
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 109 autres membres