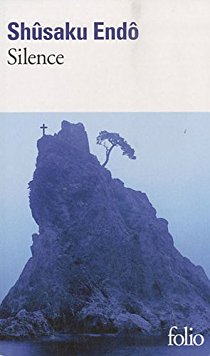"Silence", de Shûsaku Endô, et de Martin Scorsese
Préparant un prochain voyage au Japon, je me suis procuré il y a quelques semaines deux ou trois romans d’auteurs japonais pour commencer à me mettre dans l’ambiance du pays. J’ai ainsi lu, au hasard, Silence de Shûsaku Endô, pour découvrir au moment où je refermais le livre que Martin Scorsese sortait son film éponyme, tiré précisément du même roman. Dans la foulée je suis allé voir le film, qui m’a paru une transcription extrêmement fidèle du roman — le déroulé de l’histoire, les dialogues sont totalement conformes — en même temps le récit filmique porte indéniablement la marque propre de Scorsese, de ses interrogations.
Au départ Silence est un roman historique écrit en 1966 par Shûsaku Endō, écrivain catholique japonais. Sous forme littéraire de journal personnel et lettre envoyée en Europe, il illustre le drame vécu par des missionnaires jésuites au Japon du XVIIᵉ siècle qui, lors des grandes persécutions antichrétiennes initiées en 1614 par le shogun Tokugawa, sont contraints d’être témoins des tortures infligées aux paysans chrétiens japonais — sauf à apostasier leur foi : ce qu’aurait fait, selon la rumeur qui court à Rome, le Père Ferreira, ancien provincial de la Compagnie de Jésus au Japon. Trois jeunes prêtres jésuites, anciens élèves du Père Ferreira, partent clandestinement au Japon, totalement fermé aux Occidentaux et aux chrétiens depuis les persécutions, à la recherche de ce dernier, ne pouvant croire la nouvelle de son apostasie. Deux seulement finalement débarqueront, le Père Garppe et le narrateur, le Père Rodrigues. Cachés par des chrétiens qui vivent clandestinement leur foi, tentant d’exercer leur ministère auprès d’eux, ils finiront par être capturés, trahis par un personnage trouble, Kichijiro, qui les accompagne depuis le début. Le Père Garppe perd la vie. Le Père Rodrigues resté seul est soumis à de terribles souffrances morales : s’il apostasie, les chrétiens de la communauté seront épargnés. Cédant aux arguments de l'apostat Ferreira — Sawano de son nom japonais —, que les autorités lui font rencontrer dans sa prison, le Père Rodrigues finit, déchiré, par apostasier publiquement pour sauver la vie des chrétiens torturés. L’apostat Rodrigues — qui s'appellera Okada San’emon, du nom d’un Japonais qui venait de mourir, et recevra pour femme l’épouse de ce dernier —, vivra encore trente années au Japon, en résidence surveillée.
L’histoire de Silence, je la lis comme celle d’un personnage qui, déchiré par les doutes et les épreuves, se dépouille peu à peu de tout de qui l’attache à l’autorité (autorité de l’Église, autorité de sa mission d’évangélisation, autorité de la vérité universelle), pour finir, après un long combat intérieur, confronté aux souffrances des martyrs et au silence insupportable de Dieu face à ces souffrances (« Dieu… il ne fait rien pour eux, pas un geste ») par rejeter publiquement les symboles de sa foi — publiquement du moins, car la dernière image du film (la scène ne figure pas dans le roman mais Endô laisse entendre dans son récit que le prêtre a conservé intérieurement la foi) montre Rodrigues, mort, tenant dans sa main un minuscule crucifix en bois. Scorsese retrouve dans le récit d’Endô et met en scène dans son film toutes ses interrogations sur la foi chrétienne.
L’ histoire de Silence, je la lis aussi pour ce qu’elle m’apprend du Japon, ce « pays insulaire » dont les autorités, pour justifier leur rejet du christianisme, laissent entendre que leur culture ne peut rien assimiler d’étranger (« Chaque fois que vous plantez un jeune arbre dans ce marais, sa racine commence à pourrir, ses feuilles à jaunir et à sécher ») — ce pays également qui paraît entretenir avec la nature une relation de proximité très spécifique — ce n’est pas une connivence, car la nature peut être hostile (des événements récents le rappellent), mais les Japonais semblent avoir avec elle un lien sacré, qui transparaît à chaque page du récit de Shûsaku Endō. Comme si dans l’esprit japonais — c’est sans doute le fond du shintô — l’homme et la nature ne faisaient qu’un, vibraient de la même vie, partageaient le même vide devant la mort.
La présence prégnante de la nature participe à la dramatisation du récit. Ainsi de cette scène extrêmement forte, puissamment rendue par les images dans le film, où les deux prêtres, cachés dans la montagne, pas encore découverts, assistent impuissants au martyr de deux paysans japonais, Mokichi et Ichizo, condamnés au supplice de l’eau pour avoir refusé de cracher sur un crucifix et de déclarer que la Vierge était une putain :
« Pareille à une rangée de pois, on distinguait au loin une procession s’avançant sur la route inondée, couleur de cendres. Les menues silhouettes grandissaient petit à petit. Au centre, entourés par les gardes, Ichizo et Mokichi marchaient la tête basse et les bras durement liés. Les villageois ne s’aventuraient pas hors de leurs maisons verrouillées. De nombreux vagabonds, venus de villages voisins pour jouir du spectacle, formaient l’arrière-garde. Nous pouvions suivre la scène de notre hutte.
Arrivés à la grève, les fonctionnaires firent allumer un feu afin qu’Ichizo et Mokichi, trempés de pluie, puissent se réchauffer.
[…]
Deux arbres, disposés en forme de croix, furent dressés au bord de l’eau. Lorsque, à la nuit, la marée monterait elle submergerait leurs corps jusqu’au menton. Ils ne mourraient pas aussitôt, mais après deux jours, ou même trois, épuisés tant moralement que physiquement, ils rendraient le dernier soupir. Les autorités avaient pour dessein d’imposer la contemplation de cette interminable torture aux habitants de Tomogi et aux autres paysans afin de les détourner de la foi chrétienne. Il était passé midi lorsque Mokichi et Ichizo furent attachés à leurs arbres et les fonctionnaires partirent, laissant quatre gardes en surveillance. L’assistance, d’abord nombreuse, se dispersa petit à petit.
La marée monta. Les deux formes ne bougèrent pas. Les vagues, leur trempant les pieds et le bas du corps, déferlèrent au rivage sombre, avec un mugissement monotone, puis avec un mugissement monotone encore, elles se retirèrent.
[…]
La nuit vint. De notre montagne, nous distinguions faiblement le rougeoiement du feu allumé par les gardes tandis que les habitants de Tomogi, assemblés sur la plage, contemplaient la mer obscure. Les ténèbres se disputaient si bien la mer et le ciel que personne n’eût su dire où se trouvaient Mokichi et Ichizo. Personne ne savait s’ils étaient vivants ou morts. Tous priaient en silence, les yeux débordant de larmes. Alors ils perçurent, faisant écho à la rumeur des vagues, ce qui paraissait être la voix de Mokichi. Qu’il voulût faire savoir aux autres que la vie ne l’avait pas quitté ou qu’il renforçât ainsi son courage, le jeune homme, dans un râle, chantait un cantique :
Nous sommes sur le chemin, nous sommes sur le chemin,
Nous sommes sur le chemin du temple du Paradis,
Du temple du Paradis...
Du grand Temple...
Tous, en silence, écoutaient, les gardes écoutaient eux aussi, et le chant, encore et encore, leur parvenait avec le clapotis de la pluie et le grondement des vagues ».
Le lendemain, cependant que la pluie tombe toujours, les habitants de Tomogi rivent de loin leurs regards sur les croix de Mokichi et d’Ichizo :
« Lorsque la marée descendait, se dressaient lointainement les bois solitaires auxquels les deux hommes étaient liés ; indiscernables de leurs croix, Mokichi et Ichizo ne faisaient qu’un avec elles. Seul le gémissement lugubre d’une voix qui paraissait être celle de Mokichi prouvait qu’ils vivaient encore.
La plainte parfois se taisait. Mokichi n’avait même plus la force de s’affermir par un hymne. Mais, au bout d’une heure de silence, le vent apporta, une fois de plus, le son de sa voix. En l’entendant, pareille à celle d’un animal blessé, les paysans frémirent et pleurèrent. Au cours de l’après-midi, le flux remonte doucement, la froide noirceur de la mer s’assombrit encore, les croix semblent s’enfoncer dans l’eau, les vagues les ceignent d’un tourbillon d’écume, puis déferlent sur la grève, un oiseau blanc rase l’eau et s’envole loin, bien loin. Tout est fini. »
Le prêtre, rongé par le doute, est oppressé par le silence de la mer, le silence de Dieu...
"Aujourd’hui, interrompant parfois cette lettre, je sors de notre hutte pour regarder la mer, tombe de ces deux paysans japonais qui ont cru à notre parole. Seul, l’océan indéfiniment s’étend, mélancolique et sombre, et sous les nuages gris ne se dessine même pas une île.
[…]
La vie en ce monde est trop dure à ces paysans japonais. Seule leur confiance dans le « temple du Paradis » leur a permis de continuer à vivre. Telle est la funèbre nostalgie de cette complainte.
Que veux-je dire ? Je ne le comprends pas très bien moi-même, je sais seulement qu’aujourd’hui, tandis que, pour la gloire de Dieu, Mokichi et Ichizo ont gémi, souffert et rendu l’âme, je ne puis supporter le bruit monotone de la mer obscure rongeant le rivage. Derrière le silence oppressant de la mer, le silence de Dieu… le sentiment qu’alors que les hommes crient d’angoisse, Dieu, les bras croisés, se tait.
[…]
Tel le silence de la mer, le silence de Dieu. Silence sans démenti.
Non ! Non ! je secouai la tête. Si Dieu n’existe pas, comment l’homme pourrait-il supporter la monotonie de la mer et sa cruelle indifférence ? (Mais en supposant… je dis bien en supposant.) Au plus profond de mon être, une autre voix murmurait pourtant. En supposant que Dieu n’existe pas...
Terrifiante idée ! S’il n’existe pas, tout est absurde […] le plus grand crime contre l’Esprit, c’est le désespoir, mais du silence de Dieu je ne pouvais sonder le mystère."
Ainsi de bien des pages du récit, que seul un Japonais pouvait écrire, associant le sentiment de la nature à l'expression des états les plus intimes. La nature, chez nous, sert le plus souvent de toile de fond au récit, elle fait partie plutôt du décor — ici elle participe de la vie. La relation à elle du coup n'est pas simple. Les Japonais sont réputés pour leur amour des jardins, des compositions florales ( ikebana : "l'art de faire vivre les fleurs"), de la nature hautement élaborée... mais ils ont aussi, dit-on, massacré leurs paysages.
Comme le note Nicolas Bouvier (Le vide et le plein ) : "Si l'on comprenait tout, il est évident que l'on n'écrirait rien. On n'écrit pas sur : deux + deux = quatre. On écrit sur le malaise, sur les sentiments complexes qui naissent de : deux + deux = trois ou cinq."
Une bonne introduction au voyage !
A découvrir aussi
- Un management qui laisse pantois (7 juin 2008)
- La philo fait un tabac (21 novembre 2008)
- Willy Ronis, une poétique de l'engagement
Retour aux articles de la catégorie Billets d'humus -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 109 autres membres